L'argentique
Historique
Les débuts du cinéma amateur datent de 1922 : l'invention du 9,5 mm suivie par l'apparition de la caméra Pathé Baby l’année suivante permet l’avènement de caméras très compactes et faciles à charger.Le 16 mm, qui apparaît en 1923, permet de disposer d’un matériel encore plus compact et de rendre le coût de la pellicule plus attrayant aussi bien pour les professionnels que pour le public.
En 1932 Kodak lance le 8 mm, un format encore plus réduit, mais dont la petite taille nuit à la qualité de l'image.
En 1965, l'invention du super-8 permet d’agrandir l'image et de faciliter le chargement de film. C’est dans les années 1970 qu’il est devenu possible d'enregistrer le son simultanément à l’image, sur une pellicule comportant une piste magnétique.
La caméra vidéo permettant d’enregistrer les images et le son de manière synchrone sur bande magnétique a d’abord été utilisée uniquement par les professionnels de la télévision.
Il faut attendre 1985 pour que le prix de ce matériel vidéo devienne accessible au grand public et que les caméras de ce type et les magnétoscopes remplacent les caméras super-8 et les projecteurs. Aujourd’hui, alors que l’usage familial de la vidéo s’est généralisé, les professionnels du cinéma utilisent presque toujours des caméras film.
L'argentique
Une caméra argentique comporte un film qui, 24 à 25 fois par secondes, est avancé par un mécanisme d'un pas, puis arrêté. A cet instant, un autre mécanisme laisse entrer la lumière : c'est l'obturateur. Les rayons lumineux issus de l'objectif impressionnent le film, puis l'obturateur se referme, s'interposant entre objectif et film. Le film, désormais à l'abri de la lumière, avance de la longueur requise pour que les images enregistrées ne se chevauchent pas, puis il s'immobilise à nouveau. Cette avance intermittente du film est assurée par une griffe.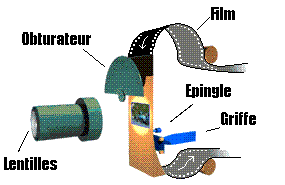
Au niveau chimique, le fonctionnement de l'impression sur un film de caméra est comparable à la prise d'une photo. Ils utilisent le principe de l'argentique. Le principe de l’argentique est que les molécules de sels argentiques qui sont réparties uniformément sur le film reçoivent la lumière lors de la prise du cliché, lorsque l'obturateur s'ouvre, et subissent une réaction chimique . Ces molécules sont au nombre de plusieurs millions au cm² (10 millions environs). L' image est alors sur le film.
Le fonctionnement d’une caméra film repose sur le principe de la photographie. En effet, la caméra fonctionne comme un appareil photo qui prendrait 24 images par seconde. Pour faciliter notre compréhension du fonctionnement d'une caméra, nous allons étudier celui d'un appareil photo.
Les appareils photos actuels sont composés d'une chambre noire (le boitier), d'un viseur, d'un déclencheur, d'un objectif, d'un diaphragme, d'un obturateur et d'un film ou un capteur, que l'on peut voir sur le schéma suivant :
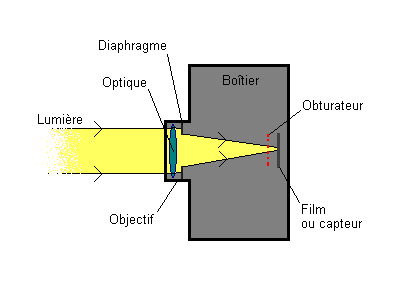
Lorsque l'on appui sur le déclencheur, la lumière passe par l'objectif car l'obturateur s'ouvre. Ainsi, cette lumière va fournir une image nette au film ou au capteur numérique.
Obectif et Distances Focales
L'objectif est un mécanisme se trouvant à l'avant de l'appareil. Il est composé de lentilles qui vont former une image sur la surface sensible du film. Le choix de l'objectif est très important car c'est lui qui est responsable de la qualité de la prise de vue. On caractérise un objectif par sa distance focale. En effet, c'est en jouant avec la distance focale différente des objectifs que l'on peut faire varier le grossissement et le champ de vision observé au travers de l'objectif. En fait, la distance focale est la distance (en millimètre) qui sépare le film du centre optique de l'objectif lorsque la mise au point est faite à l'infini.
Plus les lentilles sont proches du film (et donc plus la distance focale est courte), plus le champ de vision est large. Et l'inverse est évidemment vrai, on aura un champ de vision de plus en plus restreint lorsque la distance focale est longue.

La focale qui se rapproche le plus de la vision humaine est donnée par la diagonale du négatif.
Diaphragme
Le diaphragme se trouve lui aussi sur l'objectif. Il a un fonctionnement semblable à l'iris de notre œil : il est composé de fines lamelles se chevauchant et permet d'ajuster la quantité de lumière qui va traverser l'objectif. Sa valeur est l'ouverture, de symbole "f". L'ouverture correspond en fait au rapport du diamètre utile de l'objectif à sa distance focale (f/D).

La quantité de lumière étant divisée par deux à chaque graduation, plus l'ouverture est grande, plus le diaphragme est fermé.

Obturateur
L'obturateur est quant à lui situé au centre de l'objectif ou juste devant le film. Il est composé de lamelles métalliques se recouvrant les unes les autres. Son but est de laisser passer la lumière ou non. En effet, lorsque l'on appui sur le déclencheur, l'obturateur s'ouvre puis se referme. Comme pour l'ouverture, il existe plusieurs graduation d'obturateur dont chaque niveau divise la quantité de lumière reçue par deux. On appelle la durée durant laquelle l'obturateur est ouvert temps de pose ou vitesse d'obturation, que l'on exprime en seconde.
Profondeur de champ
La profondeur de champ est la distance qui sépare le point le plus rapproché au point le plus éloigné dont l'appareil fournit une image nette. Pour jouer sur la profondeur de champ, on peut faire varier l'ouverture du diaphragme; plus celle ci est fermée, plus la profondeur de champ est grande. On peut aussi se servir de la focale de l'objectif : en effet, plus l'on a une focale courte, plus la profondeur de champ est grande. Enfin, on peut aussi faire varier cette profondeur avec la distance appareil-sujet : plus le sujet est éloigné, plus la profondeur de champ est grande également.
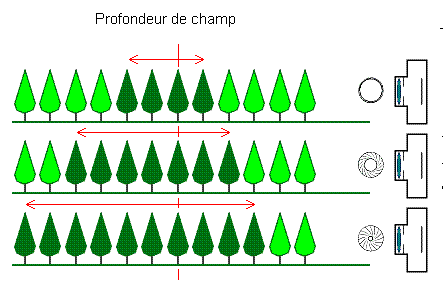
Principe de l'argentique
La quasi-totalité des procédés photographiques repose sur la sensibilité aux radiations lumineuses des cristaux d’halogénures d’argent, composés chimiques combinant l’argent à un halogène (en général, brome, chlore ou iode).
Ainsi, une pellicule photographique noir et blanc est constituée d’une feuille de matière souple, recouverte d’une couche fine d’halogénure d’argent en suspension dans la gélatine.

1 : Couche de Protection : réduit la fragilité du film 2 : Gélatine 3 : Cristaux d'Argent 4 : Adhésif : permet l'adhésion de l'émultion sur le support. 5 : Matière Plastique Transparente 6 : Adhésif + couche anti-halo : absorbe les rayons lumineux et maintient la rigidité du film.
Lorsque cette pellicule se trouve exposée à la lumière, l’halogénure d’argent subit une transformation chimique, formant sur le film une image latente. En plongeant la pellicule dans un agent chimique appelé révélateur, des particules d’argent métallique se forment alors dans les zones exposées à la lumière (phase de développement). Les parties claires du sujet photographié émettant plus de radiations lumineuses que les parties sombres, elles donnent lieu à plus de noircissement que ces dernières. C’est pourquoi l’image ainsi obtenue est appelée négatif, car les tonalités du sujet photographié sont inversées : les zones sombres de la scène apparaissent claires et réciproquement.
La pellicule est constituée d'un film support en plastique, recouvert d'une émulsion : c'est une couche de gélatine sur laquelle sont couchés en suspension des cristaux d'halogénure d'argent ; pour les émulsions modernes il s'agit de bromure d'argent (AgBr).
Plus d'un milliard d'ions d'argent (Ag+) et d'ions de brome (Br-), organisés en un réseau cubique, forment chaque cristal.
Lors de l'exposition à la lumière, une image latente se forme. Une pluie de photons provenant de la partie éclairée du sujet s'écrase sur la pellicule. Ensuite, pour chaque photon absorbé, se forme une paire électron - trou d'électron : un électron se libère du réseau et va être capté par un ion Ag+. Cet ion Ag+ est réduit, c'est-à-dire qu'il se transforme en un atome d'argent qui est exclu du réseau cristallin.
Pour chaque cristal, selon l'intensité lumineuse de la partie du sujet qu'il décrit, de zéro à une dizaine d'atomes se forment. Ces atomes ont tendance à s'agglutiner pour former un « agrégat ».
Pour les émulsions actuelles, seuls les cristaux contenant au moins trois atomes d'argent pourront être réduits lors du développement photographique, en particules noires visibles par l'œil humain (les grains d'argent voir Granularité). Le développement est un phénomène d'accélération de la réduction des ions Ag+ en atomes d'argent : les cristaux contenant un agrégat ayant un potentiel électrique supérieur à celui du révélateur, c'est-à-dire un agrégat de trois atomes ou plus, vont attirer les électrons du révélateur vers les ions du cristal, qui vont finir par tous être réduits. En revanche, les autres cristaux n'atteignant pas la masse critique de 3 atomes en agrégat rendent des électrons au révélateur et se transforment en ions invisibles. Ces ions seront ensuite dispersés lors d'une phase de lavage et de fixage. C'est la gélatine qui isole les cristaux les uns des autres et leur permet de réagir individuellement.
À cause d'un phénomène de recombinaison rapide de la paire électron-trou sans effet chimique, et de l'oxydation par le trou de certains atomes d'argent provisoirement formés, le rendement de la réaction de formation initiale des atomes d'argent est de 0,20 atome par photon. Il faut donc 15 photons pour produire les 3 atomes d'argent nécessaires à la formation des grains lors du développement. D'un point de vue macro, on peut donc constater que 80 % de la lumière qui arrive sur la pellicule est non-assimilée.
Pour restituer l’aspect initial du sujet, les deux opérations d’exposition et de développement sont réitérées afin d’obtenir une image positive reflétant la réalité (phase de tirage).
La photographie en couleurs utilise de manière similaire la photo-sensibilité des halogénures d’argent, en adjoignant aux pellicules des colorants appropriés.
Les pellicules couleur présentent un aspect plus complexe que les pellicules noir et blanc car elles doivent restituer la gamme complète des tonalités en tant que couleurs, et non seulement en termes d’intensité lumineuse. Elles utilisent le principe physique de la trichromie, selon lequel toute couleur perçue par l’œil peut être restituée en mélangeant de manière appropriée les trois couleurs primaires rouge, vert et bleu, ou encore leurs trois couleurs complémentaires respectives cyan (bleu-vert), magenta (rouge - bleu) et jaune.